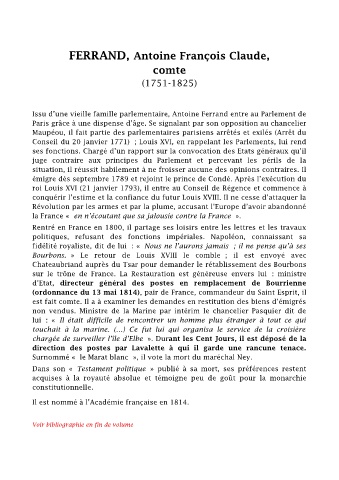Page 10 - Directeurs des postes
P. 10
FERRAND, Antoine François Claude,
comte
(1751-1825)
Issu d’une vieille famille parlementaire, Antoine Ferrand entre au Parlement de
Paris grâce à une dispense d’âge. Se signalant par son opposition au chancelier
Maupéou, il fait partie des parlementaires parisiens arrêtés et exilés (Arrêt du
Conseil du 20 janvier 1771) ; Louis XVI, en rappelant les Parlements, lui rend
ses fonctions. Chargé d’un rapport sur la convocation des Etats généraux qu’il
juge contraire aux principes du Parlement et percevant les périls de la
situation, il réussit habilement à ne froisser aucune des opinions contraires. Il
émigre dès septembre 1789 et rejoint le prince de Condé. Après l’exécution du
roi Louis XVI (21 janvier 1793), il entre au Conseil de Régence et commence à
conquérir l’estime et la confiance du futur Louis XVIII. Il ne cesse d’attaquer la
Révolution par les armes et par la plume, accusant l’Europe d’avoir abandonné
la France « en n’écoutant que sa jalousie contre la France ».
Rentré en France en 1800, il partage ses loisirs entre les lettres et les travaux
politiques, refusant des fonctions impériales. Napoléon, connaissant sa
fidélité royaliste, dit de lui : « Nous ne l’aurons jamais ; il ne pense qu’à ses
Bourbons. » Le retour de Louis XVIII le comble ; il est envoyé avec
Chateaubriand auprès du Tsar pour demander le rétablissement des Bourbons
sur le trône de France. La Restauration est généreuse envers lui : ministre
d’Etat, directeur général des postes en remplacement de Bourrienne
(ordonnance du 13 mai 1814), pair de France, commandeur du Saint Esprit, il
est fait comte. Il a à examiner les demandes en restitution des biens d’émigrés
non vendus. Ministre de la Marine par intérim le chancelier Pasquier dit de
lui : « Il était difficile de rencontrer un homme plus étranger à tout ce qui
touchait à la marine. (…) Ce fut lui qui organisa le service de la croisière
chargée de surveiller l’île d’Elbe ». Durant les Cent Jours, il est déposé de la
direction des postes par Lavalette à qui il garde une rancune tenace.
Surnommé « le Marat blanc », il vote la mort du maréchal Ney.
Dans son « Testament politique » publié à sa mort, ses préférences restent
acquises à la royauté absolue et témoigne peu de goût pour la monarchie
constitutionnelle.
Il est nommé à l’Académie française en 1814.
Voir bibliographie en fin de volume